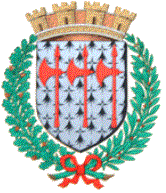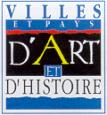|
CONCARNEAU
29110 BRETAGNE Nom Breton : KONK-KERNE Région : Bretagne Département du Finistère Arrondissement de Quimper Chef lieu de canton Population : 19453 Habitants : Concarnois Cours d'eau : Le Moros
|
CONCARNEAU ETYMOLOGIE
et HISTOIRE de CONCARNEAU Concarneau tire son
nom du latin « concha » (anse, baie) et de Kerneo. Au fond
de la baie de Cornouaille existe un îlot rocheux, le conque de Cornouailles,
autrement dit "Concq Kerneis". L'acte le plus ancien où il est question de Conc date du XIème
siècle. C'est, semble-t-il, le cartulaire de Landévennec. Celui-ci mentionne
que Gradlon donne à Saint-Guénolé (le fondateur de l'abbaye de Landévennec),
en Beuzec, cinq maisons. Le mot "en Beuzec" s'entend de la
"paroisse de Beuzec" comprenant l'îlot de Conc. Le seul prieuré que
l'abbaye de Landévennec ait eu en cette paroisse est celui de Conc. D'autres
historiens prétendent qu'un dénommé Concar, fils d'Urbien et époux d'Azénor
s'empare de la petite île de Conq qui était primitivement habitée par les
Pictes. Concar baptise sa ville Concar-Keroneos (Conkerneos) qui se traduit à
cette époque (en 692) "Concar, fils d'Urbien". Concar s'éteind en
725. Conc est pris pour la première fois par "les Français" en 799.
Ces derniers vont y rester pendant dix ans avant d'en être chassé par les
bretons en 809. Concarneau
était autrefois une ancienne trève de Beuzec-Conq que Concarneau a englobée
depuis le 27 août 1945. Il s'agit, semble-t-il, d'un démembrement de
l'ancienne paroisse primitive de Melgven (ou de Pleuven, d'après Couffon).
Beuzec-Conq doit son nom à saint Beuzec ou Budoc, fils de la comtesse Azénor.
Beuzec-Conq (noté Buezec Conc en 1325 et Bozoc Chonc
vers 1330) s’est agrandi en 1791 de sept hameaux appartenant à Trévidiern.
Beuzec était doyenné, depuis le Concordat jusqu'en 1831. C’est à
l’îlot fortifié, formant aujourd’hui la ville close, que s’est attaché le nom
de Conc. L’îlot de Conq dépend durant le Moyen Age de la paroisse de
Beuzec. Le quartier de Lochrist semble être l’ancien centre paroissial. Vers
le Xème siècle, l’abbaye de Landévennec y établit un prieuré qui deviendra la
future église tréviale (Saint-Guénolé). Les
origines de la fondation de Concarneau restent imprécises faute de documents.
Les légendes ne manquent pas. Des sondages archéologiques effectués en 1997
n'ont pas permis de découvrir en Ville-close, les vestiges d'une motte
castrale prématurément évoquée dans diverses publications. Le mystère reste
entier. Seules
certitudes, une base de tour du 13ème siècle et un mur du 14ème retrouvés
près de la Tour du Fer à Cheval viennent confirmer les premiers écrits des
Ducs de Bretagne sur l'existence d'une enceinte médiévale. Il faudra attendre
la fin du 17ème pour conserver les documents militaires et connaître
l'histoire des fortifications, remaniées jusqu'au milieu du 19ème siècle. C'est au
XIVème siècle, une forteresse puissante, occupée par une garnison anglaise
(de 1342 à 1365). A cette époque, le duc Jean IV avait gratifié de la
châtellenie de Concarneau, un Anglais, Raoul Knollès. En 1373, Bertrand du
Guesclin s'en empare et chasse les anglais. Concarneau est alors tenu par le
connétable Clisson au nom du Roi et ne verra plus la guerre jusqu'à la mort
de Jean IV en 1399. C'est le duc Jean II qui, vers 1285, aurait semble-t-il
fait entourer la ville d'une première enceinte murale. Il faut attendre 1451
pour que Pierre II, duc de Bretagne, fasse reconstruire la muraille : travaux
colossaux qui vont continuer sous Arthur III et François II (père d'Anne de
Bretagne) jusqu'en 1476-1477. Pris et repris lors de l'invasion française de
1489, le site est livré par la duchesse Anne aux Anglais, qui l'occupent
jusqu'à son retour définitif à la France en 1495. En 1532, l'union de la
Bretagne à la France met Concarneau sous la domination française et la ville
reste alors pendant près de 60 ans sous le joug de la famille les Prestre de
Lézonnet. Après une occupation huguenote en 1576, la place est fortifiée
par le duc de Mercoeur, chef de la Ligue en Bretagne. Le 17
janvier 1576, la ville de Concarneau est "surprise par les hérétiques
calvinistes, gentilshommes du pays, au nombre de 30 cavaliers environ,
conduits par les sieurs de La Vigne, le Houlle de Kermassonnet".
Assiégés du 17 au 22 janvier 1576 par la population des villages avoisinants
(plus de 8000 hommes) et par des gens armés de Quimper (sieurs de Kerharo,
Kymerch, Kerjolis, Coat-Bian, Mesle, Bodigneau, Logan, Coscaër,
Kerdégau,....), les calvinistes devront capituler. Le 26
août 1806, le vaisseau "le Vétéran", commandé par le prince
Jérôme Bonaparte, vient chercher un refuge contre une division anglaise
jusque sous les murs de Concarneau, où il reste mouillé pendant près de trois
ans. Simple
trève de Beuzec-Conq jusqu'à la Révolution, Concarneau est érigé en paroisse
lors du Concordat, et en doyenné en 1831. Les paroisses de Beuzec-Conq et de
Lanriec, aujourd'hui en Concarneau dépendaient autrefois de l'ancien évêché
de Cornouaille. La ville actuelle de Concarneau se compose de deux quartiers
: la Ville-Close (avec son enceinte couronnée d'un parapet et flanquée de grosses
tours rondes : on y pénétrait par trois portes munies de pont-levis) et le
faubourg Sainte Croix (de beaucoup le plus important aujourd'hui). Lanriec,
anciennement dans la paroisse de Trégunc, comporte depuis la fondation de la
paroisse du Passage en 1926, deux paroisses : la paroisse de Lanriec et celle
du Passage. Il s'agit sans doute, à l'origine, d'une fondation monastique (le
"lann" de saint Riec ou Rioc, disciple de saint Guénolé). On
rencontre les appellations suivantes : Conc (en 1279), Chonc (vers
1330), Conq (en 1407), Concarneau (en 1489). On
rencontre les appellations suivantes : Lan Rioc (au XIème siècle), Lanriec
(vers 1330), Lanreuc (en 1368, en 1405), Lanriec (en 1535). PATRIMOINE de CONCARNEAU l'église Saint-Guénolé
(1830), située en Concarneau. Cette ancienne église paroissiale, démolie en
1930, a remplacé un monument du XIIIème siècle qui était tombé en ruine dès
le début du XIXème siècle. Les seigneurs de Cheffontaine, possesseurs du
manoir de Coëtconq en Beuzec, avaient des droits de prééminences dans
l'église tréviale de Concarneau ; l'église du
Saint-Coeur-de-Marie (1912-1914), édifiée sur les plans de Chaussepied. Il
s'agit de l'ancienne église de la paroisse Saint-Guénolé à Concarneau. Restée
inachevée, cette église est détruite en 1994. On y trouvait jadis plusieurs
statues dont celles de la sainte Vierge, saint Guénolé, sainte Anne et saint
Michel ; l'église
Notre-Dame-de-Lorette (XIV-XVème siècle), située en Lanriec (Lanreuc, en
1368) et église paroissiale de Lanriec. Il s'agit d'un édifice rectangulaire
comprenant une nef de trois travées avec bas-côtés et un choeur d'une travée
avec bas-côté dans son prolongement. La nef date de 1477. L’arcade et les
fonts baptismaux datent de 1773. La sacristie porte la date de 1862. Le maître-autel
date de 1772. L'église abrite les statues de saint Mathurin, saint Rioc,
saint Pierre, saint André, Notre-Dame de Lorette, sainte Catherine, saint
Guénolé, saint Roch et une Vierge foulant un serpent ; l'église Sainte-Anne (1911),
située en Lanriec et église paroissiale du Passage. Il s'agit, à l'origine,
d'une simple chapelle rectangulaire, bâtie en 1911 comme chapelle provisoire
par l'entreprise Le Beux de Tregunc ; l'église Saint-Budoc
(1890-1894), édifiée vers la fin du XIXème siècle par les seigneurs de
Coatconq ou Coëtconq et située en Beuzec-Conq. Il s'agit de l'église de la
paroisse Saint-Budoc à Concarneau. L'édifice comprend, précédé d'un clocher à
une chambre sans galerie, une nef de cinq travées avec bas-côtés et un choeur
d'une travée avec bas-côtés et chevet droit. Au droit des quatrième et
cinquième travées de la nef, il y a double bas-côtés formant deux chapelles
en ailes. Le bénitier date du XVIIème siècle. Les fonts baptismaux datent du
XVIIème siècle. Le maître autel de Toularc'hoat date de 1892. Le retable de
sainte Anne, oeuvre d'Autrou de Quimper, date de 1917-1921. Un ancien
sépulcre de Notre-Seigneur était placé jadis dans le bras du transept formant
chapelle dédiée à saint Jean Baptiste : il était encadré dans un enfeu du XVème
siècle, ayant des colonnettes à larges chapiteaux qui servaient de supports
aux statues de saint Roch et de saint Sébastien. Sur l'autel se trouvait une
statue du Précurseur, avec deux jolis panneaux Renaissance. On y trouve les
statues de saint Budoc, saint Jean-Baptiste, la Vierge-Mère et sainte
Azénor ; l'ancienne chapelle
Notre-Dame-du-Portal, appelée aussi chapelle du Rosaire (XVème siècle) et
aujourd'hui disparue. En 1828, cette chapelle tombe en ruine et la vieille
tour est cassée. Elle sert tour à tour de magasin d'artillerie, de caserne,
d'école communale, d'école de pêche, de coopérative maritime et de musée de
la pêche. Sous l'Ancien Régime, les assemblées municipales s'y tenaient.
C’est à l’origine la chapelle privative du château. Les seigneurs de
Cheffontaine, possesseurs du manoir de Coëtconq en Beuzec, avaient des droits
de prééminences dans la chapelle ; la chapelle de la Croix
(XVème siècle). Elle est appelée aussi chapelle Notre-Dame de Bon-Secours. Il
s'agit d'un petit édifice rectangulaire de la fin du XVème siècle ou du début
du XVIème siècle, restauré au XIXème siècle. Le petit clocher date de 1854.
L’autel date de 1835. On y trouve plusieurs statues anciennes (la
Vierge-Mère, sainte Anne, sainte Marguerite), ainsi qu'un tableau
représentant la sainte Vierge ; la chapelle Saint-Rioc, dite
autrefois Saint-Roch et située à Lanriec. Il s'agit d'un édifice de plan
rectangulaire avec bas côté sud de cinq travées. Il n'y a pas de porte au
sud. La porte Ouest est en plein cintre surmontée d'une accolade avec
fleuron. Au nord se trouve une porte en anse de panier. La chapelle abrite un
autel en bois sculpté du XVIIème siècle et les statues de saint Joseph,
sainte Anne et la Vierge ; la chapelle du Caballou (1925),
construite avec des ruines du XVème siècle ; la chapelle de la Trinité
(XVIème siècle). Elle était la chapelle de l'ancien hôpital de la citadelle.
Cette chapelle deviendra au fils du temps, et après avoir été abandonnée par
les soeurs, une salle de réunion d'un comité révolutionnaire, puis Temple de
l'Etre Supérieur avant de servir d'école et à nouveau d'église de
secours ; la chapelle
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (1880), édifiée par les filles du
Saint-Esprit ; la chapelle Lochrist
(XVIIème siècle - 1710), restaurée en 1873. Il s'agit d'un édifice en forme
de croix dont les ailes et le chevet sont à pans coupés. Le clocheton est
amorti par un dôme. On y trouve plusieurs statues anciennes : la Trinité, le
Christ assis bénissant et tenant sa croix, la Vierge-Mère et un saint
évêque ; la croix des marins
(XVI-XVIIème siècle) ; la croix de Kerrichard
(XIIème siècle) ; le calvaire de la place de
l’église de Beuzec-Conq (1667 ou 1669) ; les remparts de la
Ville-Close (XIVème siècle), restaurés au XIXème siècle. Des fortifications
sommaires s’y trouvaient déjà dès 1240. Les murailles étaient jadis percées
de trois poternes : une à l'Ouest, appelée la porte de terre et flanquée d'un
gros donjon qui sert de demeure au gouverneur et d'une autre tour pour les
munitions. Vauban fit supprimer, au début du XVIIIème siècle, les toits des
tours pour y installer l'artillerie et fit construire les deux tours qui
veillent sur le chenal de chaque côté de la porte du passage. Une autre
poterne au Nord, la porte aux Vins, lieu de déchargement des bateaux, et
enfin à l'Est, la Poterne qui donnait accès à la Ville aux passagers du
canal. Aujourd'hui, deux ponts pavés séparés par une barbacane autrefois
pont-levis, vous emmènent à la porte principale gardée par le beffroi qui supporte
l'horloge ; le logis du major
(1730) ; la tour du gouverneur
(1477-XVIIème siècle), restaurée au XIXème siècle ; la maison du gouverneur
(XVIIème siècle). Ancien château à colombage, il s'agit en fait d'une des
plus anciennes maisons de la Ville de Concarneau. C'était jadis la résidence
des différents gouverneurs militaires. Elle communique avec un gros bastion,
la tour du major, appelée aussi Tour à munitions ou Tour de la duchesse
Anne ; le château du Moros (XVème
siècle), propriété des familles Dusquene et Perrier de Salvert. Ce château
est restauré en 1865 par le comte de Chauveau. On y trouve un pigeonnier qui
date du XVIème siècle ; le château de Stang-ar-Lin
(XIXème siècle), édifié par Gustave Bonduelle ; le château de Keriolet
(1863-1883), construit par Joseph Bigot pour Charles de Chauveau et son
épouse Zenaïde Ivanovna Narychkine (veuve en premières noces du prince
Youssoupoff) qui meurt à Paris le 20 octobre 1893. Une chapelle privative est
édifiée en 1880. Deux autels (1647) de la chapelle proviennent de l'église de
Névez. Sur les vitraux de la chapelle sont peintes des scènes de la vie du
Sauveur et de sa Sainte Mère, de Sainte Anne, de saint Jean Baptiste,... Le
retable gothique, à volets, porte en son centre le Sauveur crucifié entre
deux groupes de saints personnages. Le manoir de Keriolet (XVème siècle),
appartenait en 1775 à Euzenou, marquis de Kersalaun. Il sert aujourd'hui de
musée départemental ; la ferme du Moros (1876) en
Lanriec. Le Moros appartenait autrefois à la famille de Duquesne ; le manoir de Langoat
(XVIIème siècle). On y trouve une chapelle privative dédiée à saint Nicolas.
Son four date du XVIIème siècle ; la maison de la Vieille
Halle (XVIIème siècle) ; la taverne des Korrigans
(XVIIème siècle) ; la maison à pignon (XVIIème
siècle), située 19, rue Vauban ; la fontaine (1855-1856),
située place Guénolé ; la fontaine Saint-Budoc
(XVIIème siècle) ; la maison Penanros (XVIIIème
siècle), située 5-7, rue Tourville ; le bar de la porte au vin
(1730-1765), situé place Saint-Guénolé ; l’ancienne ferme de
Roz-Vihan (XVIIème siècle-1737) ; la maison Le Guilloroux de
Penanec’h (1736), située place Guénolé ; le fort du Cabellou
(XVIIIème siècle) ; une borne de Corvée
(XVIIIème siècle), située 145, route de Trégune ; la maison Morineau-La Bourdonnaye
(1766) ; la maison de l’émigré
Brisson (1766) ; la maison Bonne Carrère
(1787) ; le phare de Keriolet
(1848) ; la ferme de Kerdevot (1853),
située à Lanriec ; le Penfret (1844), situé 40,
rue Vauban ; les Halles (1855) ; l'ancien presbytère (1850) ; le manoir du Porzou (1865),
propriété de la famille Derval ; la maison de bois de la
digue (1885), située 22, avenue du docteur Nicolas ; la villa des Haudriettes
(1891), située boulevard Alfred Guillou ; la tour-clocher du
Saint-Sacré-de-Marie (1913), rue Turenne ; le presbytère (1938), situé
5, rue de Turenne ; l’ancien moulin à vent
(XVIIIème siècle) de Lanviec ; A
signaler aussi : la motte féodale du petit
château (moyen âge) de la Ville-Close. Ce château est encore surnommé
« vieil château » en 1495 ; la motte féodale (XIIème
siècle) de Lanriec, propriété des Thominec. Un château y est construit non
loin, propriété successive des familles Bragelonne, Lesmais, Du Plessis. Il
est en ruine dès le XVIIIème siècle ; les rochers de Kermingham
(époque néolithique), situés à Lanriec ; Sources : http://www.infobretagne.com http://www.ville-concarneau.fr/ |